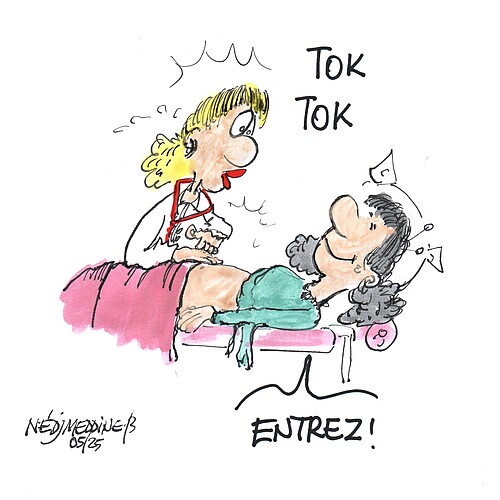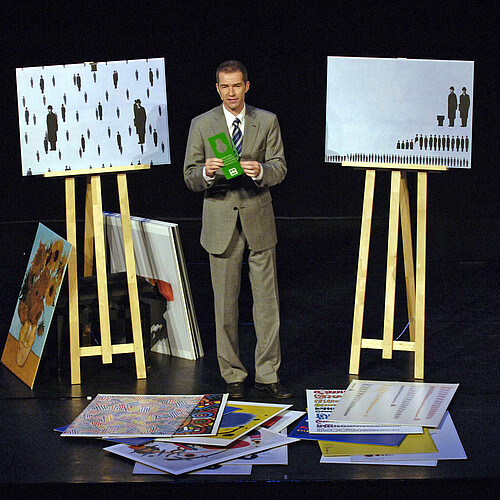- Focus: humour
Humour: une brève introduction
Qu’est-ce que l’humour? Quels effets peuvent avoir les différentes formes d’humour dans le quotidien hospitalier? Et que révèlent les blagues que nous trouvons drôles sur notre personnalité?
10.06.2025

Il n’existe pas de définition unique du mot «humour» dans la littérature actuelle. Sa signification dépend notamment du cadre terminologique utilisé. Pour moi personnellement, l’humour est une «[...] approche cognitivo-émotionnelle de situations, de la vie, du monde en général, qui dépend de la personnalité et qui se caractérise par la capacité à tirer le positif de situations négatives (dangers, menaces pour le moi, etc.), à ne pas se laisser déstabiliser, voire à pouvoir en sourire, c’est-à-dire à réagir au moins en partie avec ‹amusement›» [1]. Je distingue donc l’humour des autres styles comiques tels que la blague, le non-sens, la plaisanterie, l’ironie, la satire, le sarcasme ou le cynisme. Si on les compare, on constate que le sarcasme et le cynisme sont des notions proches, induisent une distance interpersonnelle et sont blessants. Avec l’ironie et la satire – qui constituent des formes d’allusions qui permettent de ne pas critiquer – ils offrent une vision plus «sombre» du monde.
Contrairement aux formes ludiques comme le non-sens (jeu entre sens et absurdité) et la plaisanterie (farce, blague), qui se distinguent de styles plus élaborés comme l’humour (empreint de vertu) et l’esprit (intelligence verbale, créativité). Ces quatre styles s’accompagnent généralement d’émotions positives [2].
À l’opposé, dans la recherche anglo-américaine moderne, «humour» est un terme générique qui englobe tout ce qui provoque le rire, même s’il est agressif, raciste, tabou ou sexiste – couvrant ainsi l’ensemble du spectre, du ludique au sombre.
Rire et sourire: un duo puissant
Le rire et le sourire ne sont pas seulement des expressions de joie, ils servent aussi de liant social. Des études montrent que le rire réduit le stress en libérant des endorphines. Le sourire, lui, améliore les relations et l’humeur. En milieu hospitalier, souvent marqué par des situations difficiles, cela peut avoir un impact décisif.
Un simple trait d’humour peut avoir une influence positive sur le déroulement d’un examen médical et améliorer la relation médecin-patient. Nous en avons fait l’expérience dans le cadre d’un examen de routine de dépistage du cancer du sein. Un premier groupe de patientes a reçu une carte de visite humoristique dessinée à la main, tandis qu’un deuxième groupe s’est vu remettre une carte de visite classique. Un questionnaire standardisé à compléter leur a ensuite été transmis. Résultat: les patientes ayant reçu la carte humoristique se souvenaient mieux du nom du médecin, le trouvant plus empathique, plus compétent et drôle, et ont davantage apprécié la discussion avec lui. Elles se sentaient aussi beaucoup plus détendues. Un simple geste, aussi minime soit-il, a ainsi contribué à améliorer la relation médecin-patiente [3].
L’humour à l’hôpital
De nombreux médecins utilisent l’humour noir ou le cynisme comme stratégie d’adaptation au stress. Face aux lourdes responsabilités auxquelles est confronté le personnel médical, l’humour peut ici servir d’exutoire, permettant de réduire la pression et d’offrir une certaine normalité dans des circonstances extrêmes.
On parle ici d’un «humour professionnel», propre au milieu médical, lié aux défis quotidiens du secteur de la santé et dont l’objectif est de soulager les tensions émotionnelles.
Différences entre styles d’humour
Même si différents types d’humour sont connus en milieu hospitalier, leurs fonctions diffèrent. L’humour noir peut être bénéfique dans des situations critiques, tandis que le cynisme peut nuire à la communication et à l’ambiance de travail. Il est essentiel de distinguer l’humour bienveillant de celui qui blesse ou offense.
L’humour comme stratégie face au stress
L’humour est-il toujours sain? Où placer la limite? Certes, l’humour peut être une manière efficace de gérer les facteurs de stress et de prendre de la distance face aux situations anxiogènes. Mais l’abus de cynisme ou d’humour noir peut favoriser l’épuisement émotionnel et l’isolement.
Il faut donc faire preuve de discernement: l’humour peut faire rire et rassembler, mais il peut aussi vexer et blesser. Il est important de le cultiver, mais avec conscience et respect, et de s’abstenir lorsque le contexte l’exige.
La peur du rire
Depuis quelques années, on entend également parler de «gélotophobie», ou la peur d’être victime de moqueries [4]. Certaines personnes ont vécu le rire non comme un partage, mais comme une attaque – souvent liée à des expériences d’enfance ou d’adolescence où elles ont subi des moqueries, ce qui peut avoir un effet traumatisant. Ces personnes perçoivent le moindre rire comme malveillant [5]. Même le sourire bienveillant d’un thérapeute peut être interprété comme une moquerie, les poussant à ne pas revenir [6].
Blagues et personnalité
L’humour au quotidien dépend de nombreux facteurs et est donc complexe à étudier. Certains mécanismes peuvent toutefois déjà être explorés dans les blagues et les dessins animés. Il existe deux grandes phases dans leur traitement: la surprise (incongruité) et la compréhension (résolution). Dans les blagues à structure «incongruité-résolution», l’auditeur est d’abord déstabilisé, puis surpris par une fin imprévisible, incohérente et incongrue (la chute). Cela l’incite à résoudre l’incongruité, c’est-à-dire à comprendre la blague. Pendant cette «phase de résolution», il essaie de rendre la chute cohérente avec la partie précédente.
Stéréotypes ou non-sens?
Souvent, cela repose sur des stéréotypes (blonde stupide, Écossais avare ou belle-mère méchante …). Les amateurs de ce type d’humour ont tendance à éviter l’incertitude (et apprécier la redondance) au sens de la théorie de l’information. Ils prônent le conservatisme, ne tolèrent aucune ambiguïté ou se montrent peu ouverts à de nouvelles expériences. Ils apprécient également la simplicité et la symétrie dans l’art (peinture, littérature) et sont favorables à la loi et à l’ordre ainsi qu’à l’imposition de sanctions drastiques.
Les incongruités des blagues et des dessins animés du deuxième facteur (non-sens) sont généralement plus complexes. Soit elles ne peuvent pas être résolues (en réalité), soit leur résolution entraîne de nouvelles incongruités qui, à leur tour, sont insolubles. On pense par exemple aux dessins animés de Gary Larson ou aux sketches des Monty Python. La chute est imprévisible, car elle contient des faits très fantaisistes, parfois absurdes, qui n’existent pas dans la réalité. Les incongruités sont plus étonnantes, plus fortes et plus complexes que celles du premier facteur. Le fait d’aimer le non-sens va de pair avec la valorisation du contenu informatif. Cela se traduit par des caractéristiques telles que la recherche d’expériences et l’ouverture à l’esthétique et aux idées. Un résumé des recherches montre que les personnes adeptes du non-sens apprécient les peintures complexes et fantastiques, les images complexes et les dessins au trait, les formes plus complexes de musique (jazz et classique), ainsi que la littérature grotesque [7].
En conclusion
Ce texte n’offre qu’un aperçu de la recherche contemporaine sur l’humour. Autrefois jugé inapproprié au travail, de peur de s’exposer au risque de ne pas être sérieux, voire de manquer de maturité, l’humour est aujourd’hui reconnu pour ses bienfaits. L’humour est toutefois un véritable exercice d’équilibriste, car mal utilisé, il peut blesser. Bien utilisé, il renforce les liens, allège les tensions, et crée des moments de joie partagée.
Bibliographie
- Ruch, W. (2016). Humor und Charakter. In: B. Wild (Hrsg.): Humor in Psychiatrie und Psychotherapie (2. Aufl.) (S. 8–31). Stuttgart: Schattauer.
- Ruch, W., Wagner, L. & Heintz, S. (2018). Humor, the PEN model of personality, and subjective well-being: Support for differential relationships of eight comic styles. Rivista Italiana di Studi sull’Umorismo (RISU), 1 (1), 31–44. https://www.risu.biz/wp-content/uploads/2018/01/Ruch_et_al.-RISU-11-2018-31-44-1.pdf (30.5.2025).
- Sartoretti, E., Sartoretti, T., Koh, D. M. et al. Humor in radiological breast cancer screening: a way of improving patient service? Cancer Imaging 22, 57 (2022). doi: 10.1186/s40644-022-00493-z.
- Ruch, W., Hofmann, J., Platt, T. & Proyer, R. T. (2014). The state-of-the-art in gelotophobia research: A review and some theoretical extensions. Humor: International Journal of Humor Research, 27, 23–45. https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/86447/1/humor-2013-0046.aop.pdf (30.5.2025).
- Platt, T. & Ruch, W. (2009). The emotions of gelotophobes: Shameful, fearful and joyless? Humor: International Journal of Humor Research, 22, 91–110.
- Platt, T., Proyer, R. T., Hofmann, J., & Ventis, W. L. (2016). Gelotophobia in practice and the implications of ignoring it. The European Journal of Humour Research, 4(2), 46–56.